LE ROMAN & SES PERSONNAGES
- Petite histoire du roman
- La question du personnage
- Fonctions du roman
- L’art d’analyser un roman (Enonciation, focalisation…)
- Le vocabulaire du roman et de la nouvelle
- Quelques citations sur le roman
- Le fait divers dans la littérature
- Analyse globale de l’Adversaire
- Lectures analytiques
- L’Adversaire au cinéma
- Œuvre cursive : Camus, L’Etranger
- Documents complémentaires
- Questions oral sur le roman
- Histoire des arts
- Petit quiz sur le roman
- Entrainement E.A.F
- Annexes
ETUDE DE L’ADVERSAIRE d’Emmanuel Carrère, 2000.
Influence du fait divers en littérature.


« La Gazette des tribunaux publie des romans autrement faits que ceux de Walter Scott, qui se dénouent terriblement, avec du vrai sang et non avec de l’encre ». Balzac, Modeste Mignon.
Le fait divers n’est pas né au XIX° avec le développement de la presse… mais il a connu là des conditions idéales pour prendre une place qu’il a toujours.
Le fait divers survient dans le quotidien, il est écart à une norme, quelle qu’elle soit (Psychologique, morale, sociale…) .
Le fait divers c’est la possibilité d’approcher l’horreur, l’inconcevable, l’inhabituel sans en être la victime. Alors ça plait ! Il n’y a qu’à voir le succès d’émissions TV qui retracent des enquêtes, des crimes classées dans ces fameux « faits divers ».
Déjà dans l’Antiquité, Aristote disait dans sa Poétique : « … tous les hommes prennent plaisir aux imitations. Un indice est ce qui se passe dans la réalité : des êtres dont l’original fait peine à la vue, nous aimons à en contempler l’image exécutée avec la plus grande exactitude ; par exemple, les formes des animaux les plus vils et des cadavres ».
Or le « monstre » et le « cadavre » sont les deux mamelles du fait divers…
DOSSIER - De plus en plus de romans s’inspirent d’histoires vraies. Mais qu’apportent-ils de plus à un événement qui contient tous les ressorts romanesques ?
La réalité aurait-elle plus de talent que la littérature ? On est en droit de se poser la question face au déferlement de romans «inspirés d’un fait divers» qui ne cessent de paraître. Certes, sans remonter à Flaubert et Stendhal, le phénomène n’est pas nouveau. Mais il est clair qu’il connaît une accélération. Pas de rentrée littéraire sans un récit romancé qui tire son intrigue d’une actualité passée. Parfois, le fait divers n’a même pas quitté la une des journaux ou les écrans des chaînes d’information en continu qu’il fait l’objet d’un livre. (…)
Interrogé par Le Figaro au moment de la parution de L’Enfant d’octobre,(sur l’affaire Villemin) Philippe Besson a expliqué sa démarche: «Ce qui m’intéresse dans le fait divers, c’est l’idée que la réalité est, tout à coup, plus forte que la fiction. J’avais le choix entre inventer de toutes pièces un fait divers et créer une trame à partir de lui, ou choisir une histoire qui fait, d’ores et déjà, partie de la mémoire collective et tenter d’en faire une lecture nouvelle. J’avais choisi l’affaire Grégory, parce qu’elle est, pour moi, emblématique d’un aspect qui me fascine dans certains faits divers: la rencontre de l’homme et du monstre.»
Article du Figaro : Le fait divers au secours du roman (extraits)
Par Mohammed Aissaoui Publié le 15/01/2014
Quelle marge de liberté d’interprétation?
Que peut apporter un écrivain à une histoire vraie qui contient déjà tous les ressorts romanesques ? Dans quels interstices peut-il se glisser ? Quelle marge de liberté d’interprétation dans des faits connus de tous et maintes fois relatés par la presse?
S’il se contente de rapporter les faits, il rate son coup. Sans compter que les journaux «feuilletonnent», qu’Internet démultiplie l’événement, que les télévisions possèdent la puissance des images et de la mise en scène. Le problème est là tout entier. Il faut être doté d’un certain talent pour romancer un fait divers. Prenez l’affaire d’Outreau, elle est tellement insensée, tellement incroyable qu’aucun écrivain n’aurait jamais pu l’imaginer. En fait, tout est déjà dans le fait divers. Roland Barthes l’avait expliqué voilà un demi-siècle dans ses Essais critiques: «Il est vrai que le fait divers est littérature, même si cette littérature est réputée mauvaise.»

Didier Decoin, écrit que « Le premier fait divers, c’est Caïn tuant son frère Abel !» Et d’ajouter: «Les faits divers ont toujours été une source inépuisable pour la littérature, une mine d’or.» Mais selon lui, répéter le réel ne sert à rien. Plus le romancier fera œuvre de littérature, mieux ce sera.
Peut-être qu’il vaut mieux s’emparer d’une affaire moins connue. Qui sait que le chef-d’œuvre de Truman Capote, De sang-froid, référence absolue du genre, est parti d’un crime que les journaux avaient traité par de simples brèves ?
« C’est dans l’apparente banalité que l’on écrit les meilleurs livres, le travail de l’auteur est de faire “sortir” le poussin de l’œuf, révélé ce qui n’était pas visible, percevoir ce qui n’était pas perçu», explique Didier Decoin.
Quand le fait divers est trop médiatisé, l’écrivain n’a de fait pratiquement rien à ajouter. Et, selon Decoin, pour que la fiction soit plus forte que la réalité, il faut qu’il existe un lien entre l’écrivain et le fait divers: de l’empathie, une rencontre, une résonance avec sa propre vie… C’est nécessaire. Derrière le récit, quoi qu’il relate, le lecteur doit sentir la présence de l’écrivain.
Quelques grandes affaires qui ont inspiré écrivains et cinéastes….

1990: Valérie Subra vue par Morgan Sportès dans L’Appât. Inspiré d’un fait divers qui a démarré dans les années 1980 et a été jugé en 1984. Valérie Subra, une jeune fille de 18 ans, attire des hommes dans les boîtes de nuit. Deux de ses copains détroussent, torturent et tuent les hommes séduits. Par son côté crapuleux et gratuit, l’affaire avait fait grand bruit. Après L’Appât, le roman de Sportès, Bertrand Tavernier l’a adaptée sur grand écran.
2000 : Jean-Claude Romand vu par Emmanuel Carrère dans L’Adversaire. En janvier 1993, Jean-Claude Romand, qui a menti durant toute sa vie en faisant croire à sa famille et à son entourage qu’il était médecin, tue ses deux jeunes enfants, sa femme et ses parents. Pendant près de vingt ans, on a pensé qu’il exerçait son métier à l’Organisation mondiale de la santé. En fait, il errait dans les parkings. Emmanuel Carrère avait suivi son procès.


2006: Christine Villemin vue par Philippe Besson dans L’Enfant d’octobre.
L’affaire démarre en octobre 1984. C’est l’un des plus grands faits divers que la France ait connu. Le corps du petit Grégory est retrouvé inerte, les mains et les pieds attachés, dans la rivière devenue célèbre, la Vologne (dans les Vosges). On ne connaîtra jamais l’assassin. On pense à la mère, au père, au cousin. L’affaire durera une vingtaine d’années et inspire Philippe Besson.
2006: Florence Rey vue par David Foenkinos dans Les Cœurs autonomes. En octobre 1994, Florence Rey, 19 ans, et Audry Maupin, 21 ans, décident de braquer une fourrière à Pantin, mais ratent leur coup et prennent un taxi en otage. Leur équipée sauvage et d’une violence extrême aboutit à la mort du chauffeur de taxi et de trois policiers. Maupin trouve la mort également. Mutique, Rey reste en détention durant quinze ans. Elle est sortie en 2009.

ANALYSE GLOBALE DE L’OEUVRE
L’Auteur

Né en 1957.
Diplômé de Sciences Po , journaliste notamment pour Télérama, il publie son premier roman en 1983, à l’âge de 26 ans. Puis suivront de nombreux romans couronnés par des prix littéraires comme La Classe de neige, prix Fémina en 1995. Ce roman est écrit pendant qu’il travaille, avec peine, sur L’Adversaire pour lequel il n’arrive pas à trouver la bonne distance, la « bonne place » comme il le dira dans une lettre à J.C Romand.
L’Adversaire est finalement publié en 2000 après sept ans de recherche, de questionnement et de travail. Depuis, il continue d’écrire et a publié en 2009, D’autres vies que la mienne. Dans ce livre, il met sa plume au service d’autres individus :des hommes, des femmes croisés sur son chemin ; des êtres dont les vies sont marquées par la maladie, le handicap, la perte, le deuil… Il y réfléchit sur sa propre existence, sa façon d’être au monde et son rapport aux autres.
Le titre du roman : pourquoi “L’Adversaire” ?
Qui est « L’ADVERSAIRE » ? : Pourquoi ce titre ?
Entretien avec l’auteur : Comment est venu le choix du titre, L’Adversaire ?
D’une lecture de la Bible qui était liée à mon interrogation religieuse. Dans la Bible, il y a ce qu’on appelle le satan, en hébreu. Ce n’est pas, comme Belzébuth ou Lucifer, un nom propre, mais un nom commun. La définition terminale du diable, c’est le menteur. Il va de soi que l’« adversaire » n’est pas Jean-Claude Romand. Mais j’ai l’impression que c’est à cet adversaire que lui, sous une forme paroxystique et atroce, a été confronté toute sa vie. Et c’est à lui que je me suis confronté pendant tout ce travail. Et que le lecteur, à son tour, est confronté. On peut aussi le considérer comme une instance psychique non religieuse. C’est ce qui, en nous, ment.

Culture
En hébreu, satan = “adversaire, ennemi”
- Adversaire, celui qui résiste, qui supporte
- Adversaire surhumain
Dérivant d’un verbe hébreu satân, qui signifie “s’opposer”, le terme “satan” désigne d’abord, dans l’Ancien Testament, un adversaire, et, plus particulièrement, celui qui exerce devant un tribunal la fonction d’accusateur. Il sert ensuite à désigner un être surnaturel, adversaire des hommes et de Dieu
Les thèmes
Voir votre livre !
Genres et registres dans L’Adversaire
Il y a donc dès le départ une ambiguïté sur le statut du genre puisqu’on est à la fois dans le fait et la fiction. Dans le « je » de l’auteur et dans le « il » du narrateur.
Roman ? Biographie ? Autobiographie ? Récit journalistique ?
Difficile de répondre mais ce que nous dit l’auteur ici, c’est semble-t-il qu’il a tenté d’atteindre une vérité par la narration.
Cette ambiguïté se retrouve dès l’incipit de L’Adversaire.
Genre du livre, par l’auteur lui-même
« L’Adversaire n’est pas un roman. C’est une non fiction novel, le terme est juste. L’agencement, la construction, l’écriture font appel aux techniques romanesques, mais ce n’est pas une fiction. Mon enjeu, c’est la fidélité au réel. »
Le terme non fiction novel[1] est emprunté à un écrivain américain, Truman Capote, qui publie en 1966 De Sang-froid, « roman non roman » à partir d’un faits divers.
Propos d’Emmanuel Carrère cités par Télérama, 19 janvier 2000
[1] Novel en anglais = roman
Personnages
J.C Romand : une personne-personnage…
Carrère cherche à comprendre et à faire comprendre le mensonge érigé en mode de vie plus que les crimes eux-mêmes. Car J.C Romand (son nom même est troublant !) intercepte sans cesse le réel par des « feintes », des mensonges, de la fiction. Il devient en quelque sorte le romancier de sa propre vie. Et ses « lecteurs » (sa famille, ses amis…) semblent croire à son génie et à la réalité de l’œuvre !
L’Homme :
Vu de l’extérieur
1993 : Jean-Claude Romand vit dans le pays de Gex, dans une belle maison avec sa femme et ses deux enfants, dans le pays de Gex. Il a une réputation de médecin prestigieux : il est chercheur à l’OMS, enseigne à l’Université de Dijon…Il fréquente des gens connus et respectés comme Kouchner, Schw… Il est apprécié de tous, serviable.. Bref ! un homme bien sous tous rapports ! Il a réussi sa vie sociale, sa vie familiale, aime ses parents, ses beaux parents, ses amis…
Vu de l’intérieur :
Pendant vingt ans, depuis sa deuxième année de médecine, J.C Romand ment à tout le monde. Il n’est pas médecin puisqu’il n’a jamais réussi sa deuxième année, ne travaille ni à l’OMS, ni à l’université. Il n’a pas de travail, passe ses journées dans sa voiture, escroque son entourage, prends une maitresse qu’il couvre de cadeaux et ment… sans cesse et à tout le monde. Sa vie est un vide immense remplie par le mensonge. Il s’est inventé un personnage, a créé sa vie : «Quand il faisait son entrée sur la scène domestique de sa vie, chacun pensait qu’il venait d’une autre scène où il tenait un autre rôle, celui de l’important qui court le monde, fréquente les ministres, dîne sous des lambris officiels, et qu’il le reprendrait en sortant. Mais il n’y avait pas d’autre scène, pas d’autre public devant qui jouer l’autre rôle. Dehors, il se retrouvait nu. Il retournait à l’absence, au vide, au blanc, qui n’étaient pas un accident de parcours mais l’unique expérience de sa vie».
Car derrière le personnage, derrière le mensonge nous dit Carrère, il n’y a rien : « Un mensonge, normalement, sert à recouvrir une vérité, quelque chose de honteux peut-être mais de réel. Le sien ne recouvrait rien. Sous le faux docteur Romand, il n’y avait pas de vrai Jean-Claude Romand.»
Le 9 janvier 1993, acculé, il tue sa femme et ses enfants, puis ses propres parents, met le feu à sa maison, et tente en vain de se suicider. Il survit à ce carnage. Jugé, condamné à perpétuité (22 ans incompressibles), il se tourne vers Dieu ! Quand Emmanuel Carrère lui demande s’il est croyant, il répond qu’il croit croire et que plusieurs signes –dont le prénom de l’écrivain- (« Emmanuel », qui signifie « Dieu avec nous » )le portent vers ce chemin. Deux visiteurs de prison catholiques conduiront Romand à trouver la Vérité et la Liberté que promet le Christ. Réelle transformation ou nouveau personnage, personne ne peut le dire. Pas même Carrère qui écrit : « Au personnage du chercheur respecté se substitue celui, non moins gratifiant, du grand criminel sur le chemin de la rédemption mystique.»
J.C Romand : une personne-personnage…
Carrère cherche à comprendre et à faire comprendre le mensonge érigé en mode de vie plus que les crimes eux-mêmes. Car J.C Romand (son nom même est troublant !) intercepte sans cesse le réel par des « feintes », des mensonges, de la fiction. Il devient en quelque sorte le romancier de sa propre vie. Et ses « lecteurs » (sa famille, ses amis…) semblent croire à son génie et à la réalité de l’œuvre !
Dans L’ADVERSAIRE, on a beaucoup de références ou d’allusions à des écrits non-fictionnels et connus de beaucoup de lecteurs Le Hasard et la nécessité de Jacques Monod (p. 92-93) ; Le Malheur des autres de Bernard Kouchner (p. 154).
Mais aussi des références cinématographiques comme Les Quatre Cents coups (p. 75), Le Grand Bleu (p. 92) ou Le Père Noël est une ordure . Ces références ancrent le récit dans le réel. Elles donnent de la véracité à ce qui est raconté dans L’Adversaire
C’est aussi l’effet que produit les multiples noms propres de personnalités : Alain Carignon, Bernard Kouchner, Léon Schwartzenberg, Pierre Bérégovoy…
On a également de nombreuses allusions ou références à des articles de presse (Libération, Le Monde, L’Est républicain, Le Nouvel Observateur, L’Humanité, etc.) sur l’affaire (et ce, dés le début avec la référence à l’article de Libération). Carrère lui-même a écrit des articles notamment dans le Nouvel Observateur
Mais nous savons que l’information, aussi objective qu’elle se veuille, peut rapidement être subjectivée et notre connaissance des faits est toujours « médiatisée » au sens ou nous ne la recevons pas directement. E. Carrère écrit à partir de ces masses d’information. De ce fait, sa propre conception est déjà hors de l’objectivité. Ce qu’il lit influence aussi sa perception… Bref ! Le réel est quelque chose de bien difficile à cerner.
Il y a donc à la fois un support d’informations bien réel à travers des articles mais ce même support est lui-même une « manipulation » du réel et de l’objectivité de l’auteur. Il y a d’une certaine façon, nécessairement fiction.
Et la recherche de Carrère est ailleurs, et il le dit lui-même :
« Une fois décidé, ce qui s’est fait très vite, d’écrire sur l’affaire Romand, j’ai pensé filer sur place. M’installer dans un hôtel de Ferney-Voltaire, jouer le reporter fouineur et qui s’incruste. Mais […] je me suis rendu compte que ce n’était pas cela qui m’intéressait. L’enquête que j’aurais pu mener pour mon compte, l’instruction dont j’aurais pu essayer d’assouplir le secret n’allaient mettre au jour que des faits. […] tout cela, que j’apprendrais en temps utile, ne m’apprendrait pas ce que je voulais vraiment savoir : ce qui se passait dans sa tête durant ces journées qu’il était supposé passer au bureau ; […] qu’il passait, croyait-on maintenant, à marcher dans les bois. » (p. 27 L. 467)
Carrère se positionne en écrivain, non en journaliste ou en enquêteur. Lui ce qu’il veut c’est percer le mystère « humain » qui se terre dans les actes et la vie de J.C Romand. Il veut comprendre ce qui tant sur le plan psychologique, philosophique, sociétal, métaphysique même, éclaire cet homme et son histoire. Parce qu’il pose la question de l’être, la… « question de l’homme » comme le dit votre objet d’étude.
Il s’agit de tenter d’atteindre la « vérité intérieure » de l’homme-personnage.
Dans moult romans, l’écrivain à le même désir de rejoindre cette vérité de l’homme et ne passe pour cela que par la fiction, même si celle-ci est nourrie de l’expérience de vie de l’auteur, de ses connaissances en philosophie, en psychologie, de ses observations… Mais là, c’est différent. Il s’agit d’un être réel qui devient et ne devient pas personnage. D’où la présence de nombreux référents au réel, y compris les lettres envoyés à Romand. Il y a un travail d’enquête – croisé sans cesse avec le travail de l’écrivain qui est création, imagination, empathie. C’est le travail de l’écriture qui prédomine. J. C Romand existe bien comme homme mais il existe aussi comme personnage. Et ce qui est intéressant c’est qu’il en est de même dans sa propre vie.
Un livre qui contient sa propre genèse :
L’ADVERSAIRE contient en lui-même l’histoire, les étapes de sa conception.
Après la lettre que Carrère a écrit à Romand, voici ce qu’il écrit :
« Si […] Romand ne me répond pas, j’écrirai un roman « inspiré » de cette affaire, je changerai les noms, les lieux, les circonstances, j’inventerai à ma guise : ce sera de la fiction.
Romand ne m’a pas répondu. » . Mais il lui répondra plus tard.
« J’ai commencé un roman où il était question d’un homme qui chaque matin embrassait femme et enfants en prétendant aller à son travail et partait marcher sans but dans les bois enneigés. Au bout de quelques pages, je me suis retrouvé coincé. J’ai abandonné. » (p. 36)
Ce qui est intéressant dans ce passage, c’est que la tentative de transformer totalement Romand en personnage s’avère une voie sans issue auquel l’auteur renonce. Il faut autre chose pour que le livre puisse se déployer… Carrère va mettre plusieurs années à trouver.
Et finalement à écrire ce qu’il qualifiera de « roman non roman ».
Dans un courrier envoyé à Romand, voici ce que Carrère écrit :
« Il y a maintenant trois mois que j’ai commencé à écrire. Mon problème n’est pas, comme je le pensais au début, l’information. Il est de trouver ma place face à votre histoire. En me mettant au travail, j’ai cru pouvoir repousser ce problème en cousant bout à bout tout ce que je savais et en m’efforçant de rester objectif. Mais l’objectivité, dans une telle affaire, est un leurre. Il me fallait un point de vue. […]
Ce n’est évidemment pas moi qui vais dire « je » pour votre propre compte, mais alors il me reste, à propos de vous, à dire « je » pour moi-même. A dire, en mon nom propre et sans me réfugier derrière un témoin plus ou moins imaginaire ou un patchwork d’informations se voulant objectives, ce qui dans votre histoire me parle et résonne dans la mienne. Or je ne peux pas. Les phrases se dérobent, le « je » sonne faux. » [18] (p. 205-206)
La figure du mal
J.C Romand est un imposteur. Obsédé par sa façade sociale dans un monde ou l’individu est de plus en plus réduit à cette façade, Romand n’a pas su trouver d’autre voie que de continuer sur le chemin du mensonge, jusqu’au crime.
Étienne Rabaté, dans une étude intitulée Lecture de L’Adversaire d’Emmanuel Carrère: le réel en mal de fiction (2002) écrit : « Ce qui en définitive fait défaut à Romand, c’est l’intériorité, et à sa place s’instaure comme une conscience aliénée, un moi toujours sur le point de se transformer en autre, et de détruire ce qui lui est propre» .
Romand, victime de « l’adversaire » qui l’habitait et mentait en lui, ne l’a pas combattu. On peut penser que ce mensonge aurait pu s’arrêter à plusieurs moments si la sincérité l’avait emportée. Et peut-être même en aurait-il été pardonné par les siens.
Alors, pourquoi avoir continué ?
Si Carrère a donné pour titre à son roman L’Adversaire, en donnant à ce mot sons sens biblique, c’est parce que l’écrivain considérait que Romand avait du livrer un combat contre lui-même ou contre « les forces du mal », à entendre comme une part d’ombre venu de l’inconscient.
Carrère s’explique ainsi « J’avais l’impression que l’adversaire, c’était ce qui était en lui et qui, à un moment, a bouffé et remplacé cet homme. J’ai l’impression que dans cette arène psychique qui existe en lui, se déroule un combat perpétuel. Pour le pauvre bonhomme qu’est Jean-Claude Romand, toute la vie a été une défaite dans ce combat ». (Tison, 2000)
Romand est un homme, et donc ce qui arrive à Romand questionne l’homme. Notamment l’homme pris dans la nécessité du paraître, de l’image sociale, de la nécessité de répondre à des « croyances » sur les attentes des autres (Femme, parents…)
Ainsi Carrère avait précisé dans le même entretien avec Tison, que Romand témoignait de « la part d’imposture qui existe en nous et qui ne prend que très rarement des proportions aussi démesurées, tragiques, monstrueuses» (Tison, 2000). Pour Carrère, nous sommes constitués de deux faces qui ne superposent jamais tout à fait : ce que nous montrons à l’autre et ce que nous sommes à l’intérieur de nous.
C’est toute la tragédie de Romand et c’est aussi la tragédie de l’homme : Ainsi écrit Carrère « l’ « adversaire» n’est pas Jean-Claude Romand. Mais j’ai l’impression que c’est à cet adversaire que lui, sous une forme paroxystique et atroce, a été confronté toute sa vie. Et c’est à lui que je me suis senti confronté pendant tout ce travail. Et que le lecteur, à son tour, est confronté. On peut aussi le considérer comme une instance psychique et non religieuse. C’est ce qui, en nous, ment » (Tison, 2000).
Chez Romand cette différence est exacerbée puisque, autant il brille à l’extérieur, autant il est confronté au vide et à l’obscurité à l’intérieur, passant ses journées dans sa voiture, à préparer son entrée en scène !
Mais alors quelles « forces terribles», ont conduit Romand jusqu’au massacre final ?
Dans une lettre que Carrère adresse à Romand en 1993, il lui dit:
« Ce que vous avez fait n’est pas à mes yeux le fait d’un criminel ordinaire, pas celui d’un fou non plus, mais celui d’un homme poussé à bout par des forces qui le dépassent, et ce sont ces forces terribles que je voudrais montrer à l’œuvre » .
Avec Carrère, J.C Romand n’apparaît ni comme un monstre, ni comme un fou. Ce qu’il voulait, c’était comprendre le psychisme de Romand en se mettant à sa place par l’imagination : « Ce que je voulais vraiment savoir: ce qui se passait dans sa tête durant ces journées qu’il était supposé passer au bureau; qu’il ne passait pas comme on a d’abord cru, à trafiquer des armes ou des secrets industriels; qu’il passait croyait-on maintenant, à marcher dans les bois ».
« Je ressentais de la pitié, une sympathie douloureuse mettant mes pas dans ceux de cet homme errant sans but, année après année, replié sur son absurde secret qu’il ne pouvait confier à personne et que personne ne devait connaître sous peine de mort » .
Carrère va donc chercher à comprendre cette imposture, qui ne cachait rien de délinquant, de monstrueux dans sa vie puisque Romand n’avait rien à cacher hormis ce vide : «Un mensonge, normalement, sert à recouvrir une vérité, quelque chose de honteux peut-être mais de réel. Le sien ne recouvrait rien. Sous le faux docteur Romand, il n’y avait pas de vrai Jean- Claude Romand».
Ce qui va précipiter la chute de Romand est sans doute sa relation extra-conjugale avec Corinne, une psychologue pour enfants divorcée . Romand menait avec elle « grand train », l’emmenait dans les plus grands restaurants et lui offrait des bijoux très chers. Elle lui confiera une très grosse somme d’argent qu’il est censé placer pour elle en Suisse, il le dépensera sans compter, accélérant ainsi la menace permanente d’être découvert dans son imposture.
Il est probable qu’il y ait eu chez Romand, très tôt, la construction de ce qu’en psychologie on appelle « un faux self », (un faux moi) qu’il a construit pour ne pas « décevoir » son entourage, se faire aimer de ses parents et de Florence et peu à peu, il en est devenu prisonnier.
Une mère dépressive, qu’il ne fallait pas « faire souffrir » et un père vu comme un modèle « d’honnêteté »…
Une femme de laquelle il voulait être aimé et admiré , Florence. Un mensonge en en appelant un autre, il s’est retrouvé dans une spirale infernale qu’il n’a jamais eu le courage de stopper. Son « adversaire » intérieur l’en empêchant et l’entrainant sur la pente du mensonge et de sa fin programmée. Compte tenu de son vide intérieur s’il n ‘avait plus le reflet des autres : « Sortir de la peau du docteur Romand voudrait dire se retrouver sans peau, plus que nu, écorché »(Carrère). En fait, cesser de mentir c’était aussi sans doute mourir puisque seul le personnage (le masque) existait. (Du moins à ses yeux).
On connaît la suite : Il n’y aura plus qu’une solution, éliminer tous ceux qui pourraient souffrir de découvrir la vérité. Il n’a pas vu d’autres alternatives, sans doute aveuglé par son « adversaire ».
Intérêt de l’œuvre
Au-delà de la démarche pour tenter de comprendre cette vie de mensonge, de la dimension factuel du livre qui essaie d’être au plus près du réel, ce livre n’en reste pas moins une œuvre littéraire de fiction esthétiquement réussie. Et c’est sans doute ce mélange qui provoque l’intérêt du lecteur.
D’un point de vue littéraire, l’écriture utilise les focalisations internes, le discours indirect libre, des comparaisons et des métaphores … . La forme est doc « littéraire » . Mais c’est aussi le « fond » qui intéresse le lecteur, la particularité de ce « fait divers » et son exploitation. On arrive ainsi à une situation très particulière : « L’Adversaire serait alors œuvre bicéphale, produite non seulement par le romancier, mais aussi par Romand lui-même - sans qu’il soit aisé d’établir la part qui revient à chacun d’entre eux ».
La Quatrième de couverture dans l’édition originale (P.O.L)
Dés la lecture de la quatrième de couverture, le lecteur peut s’interroger sur le genre du livre qu’il a entre les mains. Pourquoi ?
Voici ce que dit ce texte :
« Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand a tué sa femme, ses enfants, ses parents, puis tenté, mais en vain, de se tuer lui-même. L’enquête a révélé qu’il n’était pas médecin comme il le prétendait et, chose plus difficile encore à croire, qu’il n’était rien d’autre. Il mentait depuis 18 ans, et ce mensonge ne recouvrait rien. Près d’être découvert, il a préféré supprimer ceux dont il ne pouvait supporter le regard. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité./
Je suis entré en relation avec lui, j’ai assisté à son procès. J’ai essayé de raconter précisément, jour après jour, cette vie de solitude, d’imposture et d’absence. D’imaginer ce qui tournait dans sa tête au long des heures vides, sans projet ni témoin, qu’il était supposé passer à son travail et passait en réalité sur des parkings d’autoroute ou dans les forêts du Jura. De comprendre, enfin, ce qui dans une expérience humaine aussi extrême m’a touché de si près et touche, je crois, chacun d’entre nous. »
Ce texte donne à voir toute l’ambiguïté du « genre » et propose au lecteur un « code de lecture », un « contrat » :
On a d’abord un rappel des faits, en apparence objectif. « Jean-Claude Romand a tué sa femme, ses enfants, ses parents … » ; « L’enquête a révélé… »
L’énonciation est impersonnelle. Mais en apparence seulement. Car des termes comme « en vain », c’est déjà être dans le subjectif et plus seulement dans les faits. C’est une interprétation. De même, écrire qu’il « a préféré supprimer ceux dont il ne pouvait supporter le regard » est aussi de l’ordre de l’interprétation de l’écrivain qui ne peut pas être dans la tête de l’assassin. Et il n’est même pas sûr que ce dernier maitrise totalement ses motivations. Enfin, la vie de Romand comme « un mensonge qui ne recouvrait rien » est aussi interprétatif.
Dans la 2° partie du texte par contre, l’énonciation devient clairement personnelle et passe au « je » : dans un premier temps, ce « je » semble celui d’un « enquêteur », attaché aux faits :
« Je suis entré en relation avec lui, j’ai assisté à son procès. J’ai essayé de raconter précisément, (…) ». On est donc là, dans un récit qui se veut factuel (attaché aux faits).
Mais un peu plus loin, c’est du travail même de l’écrivain et non de l’enquêteur ou du journaliste qu’il s’agit. C’est un travail de création qui comme l’aurait dit Zola, passe nécessairement par « un tempérament » puisqu’il s’agit alors « D’imaginer ce qui tournait dans sa tête au long des heures vides (…) De comprendre, enfin, ce qui dans une expérience humaine aussi extrême m’a touché de si près et touche, je crois, chacun d’entre nous. »
L’auteur y explique ce qu’il a voulu faire.
LECTURES ANALYTIQUES
Préalable
Incipit, 1° partie p.9
« Le matin du samedi 9 janvier 1993, pendant que Jean-Claude Romand tuait sa femme et ses enfants, j’assistais avec les miens à une réunion pédagogique à l’école de Gabriel, notre fils aîné. Il avait cinq ans, l’âge d’Antoine Romand. Nous sommes allés ensuite déjeuner chez mes parents et Romand chez les siens, qu’il a tués après le repas. J’ai passé seul l’après-midi du samedi et le dimanche, habituellement consacrés à la vie commune, car je terminais un livre auquel je travaillais depuis un an : la biographie du romancier de science-fiction Philip K. Dick. Le dernier chapitre racontait les journées qu’il a passées dans le coma avant de mourir. J’ai fini le mardi soir et le mercredi matin lu le premier article de Libération consacré à l’affaire Romand. »
Montre l’indécision sur le genre du texte
- Incipit ou paratexte ?
- Contrat de lecture ?
- Quel effet produit cette 1° page sur le lecteur ?
- De quoi est-il question ?
Nous avons dans ce texte un parallèle entre les activités de celui qui parle, celui qui dit « je » et de celui dont on parle, Jean-Claude Romand, le 9 janvier 1993, c’est à dire le jour où il assassine sa femme et ses enfants.
La 2 ° partie du texte fait allusion au livre qu’est en train d’écrire celui qui parle.
La dernière partie correspond à la découverte d’un article qui parle de l’affaire Romand, lu le mercredi 13 janvier, donc. Et cet article sera le déclencheur d’un nouveau livre.
Ainsi ce texte fonctionne un peu comme une préface ou un avertissement de l’auteur qui nous informe sur le début du projet d’écriture. Projet qui trouve sa source à la fois dans un article (voir annexe) et la conscience d’évènements parallèles mais différents : coma de Romand / Récit du coma de K.Dick et activité quotidienne, banale d’un père de famille (réunion pédagogique à l’école de son fils) et activité « exceptionnelle » d’un autre père qui tue ses enfants et sa femme !
On se retrouve donc avec un incipit particulier, ou la personne de l’auteur rejoint celle du narrateur . En effet, si le « je » de l’auteur est employé ici : « …j’assistais avec les miens(enfants) à une réunion pédagogique »…il l’est en employé en parallèle avec le « il » qu’emploiera le narrateur dans le livre : « pendant que Jean-Claude Romand tuait sa femme et ses enfants »….
Il y a bien un fait qui déclenche l’écriture : la lecture de l’article et en même temps la rencontre de deux univers parallèles qui entretiennent pourtant des points communs. Ou en tous cas qui semblent considérés comme tels par Carrère.
Le contrat de lecture propose donc au lecteur de lire un récit « factuel », c’est à dire engendré par un fait (ici l’article relatant le crime) mais par un processus particulier qui passe par le « je » de l’auteur . En fait ici, le « je » de l’auteur est aussi le « je » du narrateur. Et donc, on ne sait plus très bien si l’on va entrer dans de l’autobiographique, du biographique ou du journalistique !
Lectures analytiques
Monsieur,
Ma démarche risque de vous heurter. Je cours ma chance tout de même.
Je suis écrivain, auteur à ce jour de sept livres dont je vous envoie le dernier paru. Depuis que j’ai appris par les journaux la tragédie dont vous avez été l’agent et le seul survivant, j’en suis hanté. Je voudrais(souhait), autant que possible, essayer de comprendre ce qui s‘est passé et en faire un livre- qui bien sûr, ne pourrait paraître qu’après votre procès.
Avant de m’y engager, il m’importe de savoir quel sentiment vous inspire un tel projet. Intérêt, hostilité, indifférence ? Soyez sûr que, dans le second cas, j’y renoncerai. Dans le premier, en revanche, j’espère que vous consentirez à répondre à mes lettres et peut-être, si cela est permis, à me recevoir.
J’aimerais que vous compreniez que je ne viens pas à vous pousser par une curiosité malsaine ou par le gout du sensationnel.
Ce que vous avez fait n’est pas à mes yeux le fait d’un criminel ordinaire, pas celui d’un fou non plus, mais celui d’un homme poussé à bout par des forces qui le dépassent, et ce sont ces forces terribles que je voudrais montrer à l’œuvre.
Quelle que soit votre réaction à cette lettre, je vous souhaite, monsieur, beaucoup de courage, et vous prie de croire à ma très profonde compassion.
Emmanuel Carrère
J’ai voulu voir les lieux où il avait vécu en fantôme. Je suis parti une semaine, /muni de plans qu’à ma demande il avait dessinés avec soin, d’itinéraires commentés que j’ai suivis fidèlement, en respectant même l’ordre chronologique qu’il me suggérait. (« Merci de me donner l’occasion de reparcourir cet univers « familier, parcours très douloureux mais plus facile à partager avec quelqu’un qu’à refaire seul… »). J’ai vu le hameau de son enfance, le pavillon de ses parents, son studio d’étudiant à Lyon, la maison incendiée à Prévessin, la pharmacie Cottin où sa femme faisait des remplacements, l’école Saint-Vincent de Ferney. J’avais le nom et l’adresse de Luc Ladmiral, je suis passé devant son cabinet mais ne suis pas entré. Je n’ai parlé à personne. J’ai traîné seul là où il trainait seul ses journées désoeuvrées sur des chemins forestiers du jura et, à Genève, dans le quartier des organisations internationales où se trouve l’immeuble de l’OMS . J’avais lu qu’une photo de grand format représentant cet immeuble était encadré au mur du salon où il a tué sa mère. Une croix marquait sur la façade, la fenêtre de son bureau, mais je ne connaissais pas la place de cette croix et je ne suis pas allé au-delà du hall.
Je ressentais de la pitié, une sympathie douloureuse en mettant mes pas dans ceux de cet homme errant sans but, année après année, replié sur son absurde secret qu’il ne pouvait confier à personne et que personne ne devait connaître sous peine de mort. Puis je pensais aux enfants, aux photos de leurs corps prises à l’institut médico-légal : horreur à l’état brut, qui fait instinctivement fermer les yeux, secouer la tête pour que cela n’ait pas existé. J’avais cru en avoir fini avec ces histoires de folie, d’enfermement, de gel. Pas forcément me mettre à l’émerveillement franciscain avec laudes à la beauté du monde et au chant du rossignol, mais tout de même être délivré de ça. Et je me retrouvais choisi (c’est empathique, je sais, mais je ne vois pas le moyen de le dire autrement) par cette histoire atroce, entré en résonnance avec l’homme qui avait fait ça. J’avais peur. Peur et honte. Honte devant mes fils que leur père écrive là-dessus. Etait-il encore temps de fuir ? Ou était-ce ma vocation particulière d’essayer de comprendre ça, de le regarder en face
Situation :
A partir de ce que R a dit lors du procès.
Juste après le meurtre de sa femme.
« Je savais, après avoir tué Florence, que j’allais tuer aussi Antoine et Caroline, et que ce moment, devant la télévision, était le dernier que nous passions ensemble. Je les ai calinés. J’ai du leur dire des mots tendres, comme : « je vous aime ». Cela m’arrivait souvent et ils y répondaient souvent par des dessins. Même Antoine qui ne savait pas encore bien écrire savait écrire « je t’aime ».
Un très long silence. La présidente, d’une voix altérée, a proposé une suspension de cinq minutes, mais il a secoué la tête, on l’a entendu déglutir avant de continuer :
« Nous sommes restés comme ça peut-être une demi-heure… Caroline a vu que j’avais froid, elle a voulu monter chercher ma robe de chambre… J’ai dit que je les trouvais chauds eux, qu’ils avaient peut-être de la fièvre, que j’allais prendre leur température. Caroline est montée avec moi, je l’ai fait coucher sur son lit…Je suis allé chercher la carabine… »
La scène du chien a recommencé. Il s’est mis à trembler, son corps s’est affaissé. Il s’est jeté au sol. On ne le voyait plus, les gendarmes étaient penchés sur lui. D’une voix aigu de petit garçon, il a gémi : « Mon papa !Mon papa ! » Une femme, sortie du public, a couru vers le box et s’est mise à taper sur la vitre en suppliant « Jean-Claude ! Jean-Claude ! » comme une mère. Personne n’a eu le cœur de l’écarter.
- « Qu’avez-vous dit à Caroline ? a repris la présidente après une demi-heure de suspension.
-Je ne sais plus… Elle s’était allongée sur le ventre…C’est là que j’ai tiré.
- Courage…
- J’ai déjà du le dire au juge d’instruction de nombreuses fois, mais ici… ici, ils sont là…(sanglot). J’ai tiré une première fois sur Caroline…elle avait un oreiller sur la tête…J’avais du faire comme si c’était un jeu… (Il gémit, les yeux fermés). J’ai tiré…J’ai posé la carabine quelque part dans la chambre… J’ai appelé Antoine…Et j’ai recommencé.
- Il faut peut-être que je vous aide un peu car les jurés ont besoin de détails et vous n’êtes pas assez précis.
- …Caroline, quand elle est née, c’était le plus beau jour de ma vie…Elle était belle…(Gémissement…) Dans mes bras… pour son premier bain… (Spasme). C’est moi qui l’ai tué…C’est moi qui l’ai tué…
(Les gendarmes le tiennent par le bras avec une douceur épouvantée).
- Vous ne pensez pas qu’Antoine a pu entendre les coups de feu ? Aviez-vous mis le silencieux ? L’avez-vous appelè sous le même prétexte ? Prendre sa température ? Il n’a pas trouvé ça bizarre ?
- Je n’ai pas d’image de ce moment précis, c’était encore eux, mais ça ne pouvait pas être Caroline… ça ne pouvait pas être Antoine…
- Est-ce qu’il ne s’est pas approché du lit de Caroline ? Vous l’aviez recouverte de sa couette pour qu’il ne se doute de rien…
(Il sanglote)
- Vous avez dit à l’instruction que vous avez voulu faire prendre à Antoine du Phénobarbital dilué dans un verre d’eau et qu’il avait refusé en disant que ce n’était pas bon…
- C’était plutôt une déduction… Je n’ai pas d’image d’Antoine disant que ce n’était pas bon…
- Pas d’autre explication ?
- J’aurais peut-être voulu qu’il dorme déjà ».
L’avocat général est intervenu : vous êtes sorti ensuite acheter l’Equipe et le Dauphiné libéré, et la marchande de journaux vous a trouvé l’air tout à fait normal. Etait-ce pour faire comme si rien ne s’était passé, comme si la vie continuait ?
- Je n’ai pas pu acheter l’Equipe. Je ne le lis jamais.
- Des voisins vous ont vu traverser la rue pour relever votre boite à lettres.
- Est-ce que je l’ai fait pour nier la réalité, pour faire comme si ?
- Pourquoi avoir emballé et rangé avec soin la carabine avant de partir pour Clairvaux ?
- En réalité, pour les tuer, bien sûr, mais je devais me dire que c’était pour la rendre à mon père. »
Habitué à ce que le labrador de ses parents salisse ses vêtements en lui faisant fête, il a passé une vieille veste et un jean, mais accroché au porte-manteau de la voiture, un costume de ville en prévision du dîner à Paris. Il a mis dans son sac une chemise de rechange et sa trousse de toilette.
Il ne se rappelle pas le trajet. Il se rappelle s’être garé devant la statue de la Vierge que son père entretenait et fleurissait chaque semaine. Il le revoit lui ouvrant le portail. Ensuite, il n’y a plus d’image jusqu’à sa mort.
On sait qu’ils ont déjeuné tous les trois. Il restait des couverts sur la table quand l’oncle Claude est rentré dans la maison le surlendemain, et l’autopsie a révélé que les estomacs d’Aimé et Anne-Marie étaient pleins. A-t-il mangé, lui ? Sa mère a-t-elle insisté pour qu’il le fasse ? De quoi ont-ils parlé ?
Il avait fait monter ses enfants à l’étage, chacun son tour, il a fait la même chose avec ses parents. D’abord son père, qu’il a entrainé dans son ancienne chambre sous prétexte d’examiner avec lui une gaine d’aération qui diffusait de mauvaises odeurs. A moins qu’il ne l’ait fait en arrivant, il a du monter l’escalier la carabine à la main. Le ratelier ne se trouvait pas en haut, il a peut-être annoncé qu’il allait, de la fenêtre, faire un carton dans le jardin, plus probablement, rien dit du tout. Pourquoi Aimé Romand se serait-il inquiété de voir son fils porter la carabine qu’il était allé acheter avec lui le jour de ses seize ans ? Le vieil homme, qui ne pouvait se pencher en raison de problèmes lombaires, a du s’agenouiller pour montrer la gaine défectueuse, à hauteur de plinthe. C’est alors qu’il a reçu les deux balles dans le dos. Et est tombé vers l’avant. Son fils l’a recouvert d’un dessus de lit en velours côtelé lie de vin qui n’avait pas changé depuis son enfance.
Ensuite, il est allé chercher sa mère. Elle n’avait pas entendu les coups de feu, tirés avec le silencieux. Il l’a fait venir dans le salon dont on ne se servait pas. Elle seule a reçu les balles de face. Il a du essayer, en lui montrant quelque chose, de lui faire tourner le dos. S’est-elle retournée plus tôt que prévu pour voir son fils braquer la carabine sur elle ? A-t-elle dit : « Jean-Claude, qu’est-ce qui m’arrive ? » ou « qu’est-ce qui t’arrive ? » Comme il se l’est rappelé lors de l’un des interrogatoires pour dire ensuite qu’il n’en avait plus le souvenir et le savait seulement par le dossier d’instruction ? De la même façon incertaine, en essayant comme nous de reconstituer les faits, il dit que dans sa chute, elle a perdu son dentier et qu’il le lui a remis avant de la recouvrir d’un dessus de lit vert.
Le chien, monté avec sa mère, courait d’un corps à l’autre sans comprendre, en poussant de petits gémissements. « J’ai pensé qu’il fallait que Caroline l’ait avec elle, dit-il. Elle l’adorait ». Lui aussi l’adorait, au point de garder en permanence sa photo dans son portefeuille. Après l’avoir abattu, il l’a recouvert d’un édredon bleu.
L’ Adversaire au cinéma
Après des études de philosophie et les cours du Centre dramatique de la rue Blanche et du Conservatoire national d’art dramatique, Nicole Garcia emprunte la carrière de comédienne. Au théâtre tout d’abord, mais aussi au cinéma ou elle y a jouer de nombreux rôles pour des réalisateurs tel que Bertrand Tavernier (Que la Fête commence), Henri Verneuil (Le Corps de mon ennemi), Alain Resnais (Mon Oncle d’Amérique), Claude Lelouch (Les Uns et les Autres), Pierre Schoendoerffer (L’Honneur d’un capitaine), Claude Sautet (Garçon) et Michel Deville (Péril en la demeure).
En 1985 elle réalise le court métrage Quinze août avec comme comédiennes Ann Gisel Glass et Nathalie Rich. Puis elle réalise plusieurs long métrages : Un week-end sur deux (1990), Le Fils préféré (1994) et Place Vendôme (1998). L’adversaire, basé sur l’affaire Romand, est sont quatrième long métrage.
Rencontre au MK2- Quai de Seine, le 9 juillet 2002, retranscrite
Cinélycée.com, Par Clémentine GALLOT
Site source : http://www.objectif-cinema.com/interviews/166.php
L’Adversaire (c) D.R.
Cinélycée : Comment se passe le travail du cinéaste à partir d’un fait divers ?
Nicole Garcia : Je pense que le cinéma travaille sur une trame: elle est donnée ici par ce fait divers. J’en ai pris connaissance au moment des faits; il a été largement rapporté par les médias. C’est quand j’ai lu le livre de Carrère (L’adversaire) que j’ai découvert un personnage dont l’émotion existentielle m’a bouleversée. Il y avait, pour moi, la possibilité de filmer une tragédie. Il y avait ce caractère inexorable, car tout est déjà joué avant que le film ne commence. Ce personnage est tragique, absolu. La tragédie antique trouve sa transcription dans notre époque par le roman noir ou le fait divers. C’est un homme qui tombe et se voit tomber. Ce destin, cette aventure m’ont intéressée, beaucoup plus que l’aspect du mensonge. Je l’ai senti proche de nous, de la condition humaine, par sa propension à se faire des nœuds : il tombe dans le piège qu’il s’est préparé. La part sombre, qu’il y a en chacun de nous, le dévore jusqu’à une impasse : choisir entre son mensonge et la vie de ceux qu’il aime.
Cinélycée : Le meurtre final, pour vous, ça fait partie de la tragédie ? Est-ce que ça ne pouvait pas être en dehors du film ?
Nicole Garcia : Non, car Romand va au bout de sa course : c’est l’accomplissement et l’anéantissement en même temps. S’il partait, cela signifierait que le petit théâtre pour lequel il avait joué cette comédie allait être éclairé sur ce mensonge. Le dévoilement lui était plus insupportable qu’autre chose : on peut parler d’un narcissisme criminel. S’il y a en lui une folie, elle est fusionnelle, car les autres c’est lui, et les tuer c’est se tuer (il se comprend dans la destruction). A la fin du film, on entend “il est vivant” : c’est la plus grande tragédie, car il est vivant dans un monde qu’il a incendié.
Cinélycée : Comment arrive- t-on a réaliser un film sur un personnage encore vivant, lorsque la fiction s’éloigne très peu du fait divers ? D’autant plus que dans le livre, Carrère entretient une correspondance avec Romand.
Nicole Garcia : Ce genre de film est une sorte de parcours balisé, on se doit d’être fidèle aux faits : le livre d’Emmanuel Carrère rapportait des faits policiers et judiciaires, alors que nous avions la charge d’inventer tout le reste, par exemple la relation qu’il avait avec ses enfants, ses amis, sa maîtresse. Il y a donc une part de fiction. Je ne suis pas allé voir Romand, sinon ça aurait été un documentaire ! J’ai volontairement abandonné le personnage du fait divers.
Autres documents
La double vie consumée de Jean-Claude Romand (Article Libération du 16 janvier 1993)
Par Florence AUBENAS, Prévessin-Moëns, envoyée spéciale —
 Jean-Claude Romand est assis dans le box des accusés pour l’ouverture de son procès, le 25 juin 1996 devant la Cour d’assises de l’Ain au palais de justice de Bourg-en-Bresse. AFP
Jean-Claude Romand est assis dans le box des accusés pour l’ouverture de son procès, le 25 juin 1996 devant la Cour d’assises de l’Ain au palais de justice de Bourg-en-Bresse. AFP
[Article paru le 16 janvier 1993] Pour sa femme, ses enfants, ses parents, il a toujours été un médecin brillant. Un soir, il les a tués. Puis, deux jours après, a tenté de se suicider. Alors qu’il sort du coma, l’enquête révèle qu’il escroquait ses proches depuis des années.
Doucement, tout doucement, il semble ressusciter. Conduit lundi à l’aube à l’hôpital de Genève, Jean-Claude Romand paraissait avoir à peine un lendemain à vivre. Les pompiers viennent alors de le tirer de sa villa en flammes, à Prévessin, un petit bourg français blotti contre la frontière suisse.
Cette nuit-là, Jean-Claude Romand a avalé de l’essence, des médicaments aussi peut-être. Puis il a calfeutré les portes, les fenêtres, allumé un brasier. A côté de lui, sur le lit conjugal, les pompiers découvrent sa femme, Florence, morte. Et dans la chambre des enfants, deux cadavres carbonisés. Pour le survivant, «état critique et coma profond», diagnostiquent pendant trois jours les médecins suisses.
Trois jours au cours desquels l’autopsie révèle que Florence Romand et les enfants ont été assassinés. D’autres enquêteurs, plus haut vers le Jura, découvrent ensuite les parents de Jean-Claude, dans la maison familiale. Morts eux aussi. Puis, d’un coup, lors d’une banale vérification, c’est une existence entière qui bascule.
«Jean-Claude Romand avait une double vie dont il était le seul à connaître l’existence, explique Jean-Yves Coquillat, premier substitut au tribunal de Bourg-en-Bresse. Ni ses intimes ni même sa femme ne l’ont soupçonné pendant vingt ans.» Et, dans un lit blanc, à l’hôpital de Saint-Julien-en-Genevois, où l’amélioration de son état a permis son transfert en fin de semaine, c’est cet homme-là qui va se réveiller, celui que les enquêteurs s’apprêtent à entendre en début de semaine prochaine.
En bordure de la Suisse, le pays de Gex, vert et vallonné, ne ressemble à rien d’autre dans le département de l’Ain. Depuis les années 60 s’y est installée une tribu dorée de cadres supérieurs, de fonctionnaires internationaux, de commerçants aisés, qui jouent à saute-frontière entre les salaires suisses et l’art de vivre français. D’emblée, entre soi, on s’y tutoie, on s’y embrasse, on s’y reçoit. On y affiche sans façon «à l’américaine», dit-on des maisons et des voitures au luxe tranquille. Lorsque les Romand y arrivent en 1984, ils semblent y avoir trouvé leur terre promise.
Le jeune couple n’a bien sûr alors qu’un petit appartement et une Volvo. Mais lui compte bien asseoir sa situation de chercheur, qu’il dit prometteuse, au sein de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) à Genève. Elle est pharmacienne. Leur vie se décline, nette et pimpante, comme un faire-part.
Il y a leur rencontre dans le Jura, dont il est originaire, provenant d’une famille modeste, et où elle passait ses vacances. Puis leurs études à Lyon, dans les années 70. Leur mariage, en 1980. Le diplôme de Jean-Claude en 1983. Puis la naissance de Caroline en 1985 et celle d’Antoine en 1987. En 1990, ils s’installent enfin dans une villa, roulent en BMW. Florence a tenu à ce que les enfants soient inscrits dans le privé, à l’institut Saint-Vincent, tout à côté de Prévessin, une des écoles les plus choyées du département. Elle y assure d’ailleurs un rôle actif dans l’association des parents d’élèves, avant de filer au catéchisme à Prévessin, avec le père Michel, ou d’aider à la pharmacie où elle fait des remplacements. Et tout cela, avec un de ces sourires, une de ces élégances qui font la fierté du pays de Gex.
Jean-Claude, lui, est plutôt discret. «Solide, silencieux, les pieds bien sur Terre comme un sapin de son Jura», dit l’un de ses amis. Son assurance et sa stature de chercheur lui ont valu auprès de ses parents dont c’est le fils unique et dans sa belle-famille le rôle rassurant de confesseur. Pour un problème de santé, c’est à lui qu’on confie son corps. Pour un problème d’argent, c’est à lui qu’on confie son compte. A Prévessin, il fréquente surtout le milieu médical. Il est abonné à toutes les revues spécialisées, débat sur la culture cellulaire.
Un soir, autour d’un dîner intime, on l’interroge sur ses études. «Je n’ai jamais voulu vous le dire, cela aurait paru prétentieux. Mais j’ai été reçu cinquième à l’internat de Paris», annonce tranquillement Jean-Claude à l’assemblée. Même sa femme Florence est ébahie. «C’était tellement dans sa nature de ne pas se vanter que, pour nous, cela confortait encore une image que nous avions de lui», se souvient un des convives, ami de faculté de Romand. Ensemble, à Lyon, ils ont bûché leur première année. Mais seul Jean-Claude l’a eue.
«Il était très doué, très bosseur, vraiment bon dans les matières scientifiques», se souvient le copain. A une année d’écart, les deux amis se suivent, de stages en amphithéâtres. «On ne parlait pas spécialement de résultat, reprend l’ami. Mais il y avait toujours des polycopiés ou des notes plein sa chambre d’étudiant à Lyon.»
«Dans sa vie professionnelle aussi, Jean-Claude Romand a mis plus d’énergie à s’inventer une activité qu’il ne l’aurait fait à travailler réellement», explique le substitut Coquillat. Car c’est à l’OMS que se sont tout naturellement d’abord rendus les enquêteurs de la gendarmerie, après la découverte des meurtres. Jean-Claude Romand, inconnu. Occupé par un autre, ce bureau dont il désignait les fenêtres avec fierté, en passant en voiture avec ses enfants. Jamais vu, même à la bibliothèque, ce chercheur qui proposait à ses confrères de leur ramener des photocopies d’articles médicaux.
Dans la villa de Prévessin, les enquêteurs découvrent un opérateur Télécom, ces petits appareils qu’on porte à la ceinture et qui «bipent» lorsque quelqu’un cherche à vous joindre. «Il disait qu’il n’était pas souvent à son bureau, explique un parent de Florence. Mais maintenant, on se demande ce qu’il pouvait bien faire pendant toutes ces journées où il disait travailler au laboratoire, assister à des conférences à Genève ou à l’étranger.»
Puis les enquêteurs sont remontés à Lyon. Si le docteur de Prévessin a bien réussi sa première année, il s’est inscrit douze ans de suite en seconde année, sans jamais se présenter à l’examen. «Le pire, c’est qu’il aurait été tout à fait capable de réussir, s’exclame un de ses confrères. C’est pour cela que je n’arrive pas encore à y croire. En plus, il avait la vocation.» «Ce qui est aussi incroyable, c’est qu’il n’a jamais cherché à escroquer davantage que pour assurer l’équivalent d’un traitement de médecin aisé dans le pays de Gex», relance, perplexe, un enquêteur ; et toujours auprès de proches qui lui faisaient une totale confiance.
Dans la famille de Florence, on commence à regarder les placements, les petits bouts de terrain, les petits bouts de retraite, les économies qu’il disait faire fructifier «en Suisse».
A une amie intime, Chantal, il avait aussi proposé des placements intéressants. En deux ans, elle lui avait confié 900 000 francs. C’est elle qu’il a appelée une semaine avant l’incendie, pour lui donner rendez-vous le samedi 9 janvier à Paris. A cette date-là, le compte en banque de Jean-Claude Romand est vide, vide comme il ne l’a jamais été, vide à ne même plus pouvoir payer la location de la BMW, «une voiture mise à sa disposition par l’OMS», disait-il.
La veille, le 8 janvier, dans l’après-midi, Florence sort acheter du pain. Comme d’habitude, elle en veut un «qui dure le week-end» pour tous les goûters des enfants. Un signe de la main, son sourire, elle disparaît. Dans la soirée, la BMW se gare devant la villa, Jean-Claude Romand descend, se dirige vers la chambre. Il vide sur eux le chargeur d’une 22 long rifle. Lorsque Florence s’approche, il n’a plus de balle. Il lui écrase la tête. Puis il part vers Paris.
Chantal l’attend, elle ne sait rien, elle parle placement. Il l’entraîne dans la forêt de Fontainebleau et l’asperge de gaz lacrymogènes. Chantal le supplie de l’épargner. Il la regarde longuement, la reconduit chez elle. Puis il file sans un mot dans le Jura, chez ses parents. Il a rechargé l’arme. Il tire à nouveau, avant de repartir, borde les deux cadavres. Dimanche, Jean-Claude Romand est seul dans la villa de Prévessin. Pendant vingt heures, il arpente les pièces. A 4 heures du matin, il craque une allumette.
Dans la BMW, on a retrouvé un mot sur le pare-brise : «Un accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon Chantal.» Jusqu’à son audition, il y a deux jours, elle le croyait encore chercheur. Elle croyait encore cet autre Jean-Claude Romand, qui, lui, est mort dans les flammes.
[Article paru le 16 janvier 1993]
Epilogue
Jean-Claude Romand a été condamné en juillet 1996 par la cour d’assises de l’Ain à la peine maximale : réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans. Son histoire a inspiré un documentaire de Gilles Cayatte et Catherine Erhel, le Roman d’un menteur, un livre d’Emmanuel Carrère, l’Adversaire (éd. POL, janvier 2000), un long métrage adapté du roman de Carrère et réalisé par Nicole Garcia, l’Adversaire. Le film l’Emploi du temps de Laurent Cantet s’inspire librement du personnage. Détenu modèle, Jean-Claude Romand est bibliothécaire dans sa prison.
Florence AUBENAS Prévessin-Moëns, envoyée spéciale
1. Comment Carrère brouille-t-il la frontière entre les genres dans son livre ?
- Dés le départ, il emploie le “je” et se pose en témoin. Il parle à la fois de J.C Romand et de lui-même (cf. incipit)
- Sa correspondance avec Romand montre les étapes, les démarches de l’écrivain (lettres p. 36 et 39)
- En relatant des moments du procès, et en disant qu’il y était comme journaliste (p. 46, 77, etc.)
- En utilisant des noms de lieux et de personnes réelles auxquels il ajoute un personnage fictif (Ladmiral)
2. Pourquoi ce titre ?
(voir cours)
3. Avez-vous trouvé ce livre dérangeant ? Pourquoi ?
4. Quels autres romans basés sur des faits divers connaissez-vous ?
(A compléter)
- Quels liens pouvez-vous établir entre les textes étudiés au cours de la séquence?
- Quelles visions du personnage romanesque les différents auteurs cherchent-ils à donner à travers votre corpus?
- De quelle visoin du monde les personnages de votre corpus témoignent-ils?
- Quelle place occupe le narrateur dans vos trois textes?
- Qu’est-ce qu’un narrateur ?
- Expliquez les points de vue.
- Quand le roman est-il né en France ?
- Quelle évolution le genre romanesque a-t-il connue au cours des siècles ?
- Qu’apporte le XIXe siècle au genre romanesque ?
- Qu’est-ce qui caractérise le roman moderne ?
- Qu’est-ce qu’un roman autobiographique ?
- Qu’appelle-t-on un roman de formation ?
- Qu’est-ce que le naturalisme / le nouveau roman… ? (selon les textes étudiés)
- Citez des auteurs réalistes.
- Quelles visions du monde peut offrir le roman ?
- Comment un personnage de roman peut-il transmettre une vision du monde au lecteur ?
- Expliquez la construction et l’évolution du personnage de roman. Comment le romancier fait-il comprendre au lecteur ce que découvre son personnage ?
- Quelle place le romancier accorde-t-il au corps du personnage ? Comment le lecteur peut-il s’identifier au personnage ? Est-ce souhaitable ?
- Quels rapports l’auteur entretient-il avec son personnage ?
- Quelles qualités doit avoir un personnage de roman pour plaire au lecteur / pour être le héros du roman ?
- Que savez-vous de l’évolution du personnage de roman au fil du temps ? Qu’appelle-t-on un héros positif / négatif, un antihéros, un héros collectif ?
- Quelles différences y a t-il entre un personnage de roman et un personnage de théâtre ?
- Qu’est-ce qui différencie le roman des autres genres littéraires ? Qu’est-ce qui caractérise l’écriture romanesque par rapport à d’autres formes littéraires ?
- Quels sont les points communs / les différences entre un roman et un film ?
- Quelles sont les fonctions du roman ?
- Quel rapport le roman entretient-il avec la réalité ?
- On dit parfois que dans un roman les descriptions sont ennuyeuses : qu’en pensez-vous ? // A quoi servent les descriptions dans un roman ? Quelles sont les fonctions de la description dans la représentation des personnages ?
- Quelles qualités doit avoir un début / une fin de roman réussi(es) ?
- Diriez-vous que la lecture du roman que vous avez étudié cette année a contribué à modifier votre vision du monde ?
- Quel intérêt y a-t-il à étudier un roman ?
- Qu’attendent les lecteurs d’un roman ?
- Qui est selon vous le plus grand romancier français ? Pourquoi ?
- Quels sont les romans qui vous plaisent / vous déplaisent ? Pourquoi ? Quelles qualités doit avoir un bon roman selon vous ?
Documents complémentaires sur le Roman et le personnage
La vérité du roman n’est jamais autre chose qu’un accroissement de son pouvoir d’illusion. Mais d’où lui vient ce pouvoir, et surtout, pourquoi ce désir si impérieux de l’exercer ? Si la théorie ne songe pas à se le demander, en revanche le sentiment populaire le sait, ou du moins il le laisse entendre dans les images où il dépose ses jugements. Pour le langage courant, en effet, art de conter et mensonge sont si étroitement associés qu’ils semblent confondus dans la même réprobation, mais cette synonymie est plus ambiguë qu’elle n’y paraît, car elle suppose entre les deux termes un lien de réciprocité, un commerce naturel dont l’art n’est pas sans tirer profit (il est moins avili par le contact du mensonge que le mensonge n’est ennobli par le sien). Ainsi on dit « c’est du roman » pour désigner un tissu de fables incroyables ; mais « c’est un roman » s’applique à un fait trop merveilleux ou trop touchant pour prendre rang parmi les choses jugées possibles ; dans un cas, le roman est donc assimilé à un mensonge purement négatif ; dans l’autre, en revanche, il désigne une expérience ou des événements pour quoi la réalité n’a pas de nom, mais qui la surpassent de beaucoup en émotion et en beauté.
Il faut le dire et le redire sans compter : il y a un lien indestructible entre le roman et le personnage ; qui attente au second ne peut que porter atteinte au premier. La catharsis ne peut se passer du personnage. C’est une énigme, et c’est un fait : nous avons besoin de projection, de transfert, d’identification. Pour que la fiction opère, nous avons besoin de croire à l’existence d’un personnage en qui se résument et se concentrent les actions qu’organise la fable. Le fonctionnement même du texte le veut : sa vérité est obligée de passer par des simulacres de mots ; et la vie même et l’âme de l’auteur de se couler vivantes dans la figure de papier qui le représente. Et qui, dans le même temps, le sauve […].
Est-ce à dire que notre lecture hallucinée oublie de voir dans le personnage un être de fiction, et nous fait croire à son existence hors du texte ? Non pas. Le personnage vit, sans doute : mais nous savons fort bien de quelle vie. C’est la vie d’une illusion. Ni plus ni moins. Le personnage existe, mais dans la fiction, d’une existence fictive. Comme le roi Lear « existe » sur la scène, d’une existence scénique.
L’illusion littéraire suppose un consentement à la croyance temporaire dans la réalité imaginaire des choses fictives. « Héros » d’Homère ou personnage de Balzac, ou simple voix, sans corps ni sexe, de la fiction moderne, le personnage est « entre deux mondes », issu de l’expérience imaginaire ou réelle de l’auteur, et de l’agencement « mimétique » de ses actions, le personnage vient vers le lecteur comme une proposition de sens à achever. Pour parvenir à cette fin, l’auteur a dû lui-même se métamorphoser en un être de fiction, en une figure de pensée, le narrateur, qui se constitue dans l’ordre même qu’il impose à ses objets. L’auteur, en un sens, est devenu un personnage de son propre roman, il se met lui aussi à exister « entre deux mondes », entre le monde de la fiction et le monde vrai auquel il appartient encore un temps. C’est sur ce modèle que le lecteur va plus tard se couler.
Ce battement du réel et de l’imaginaire qui nous saisit pendant la lecture est l’essence de la fiction dramatique ou épique. Une feinte, tout entière au service de la création romanesque, du bonheur du lecteur, du fonctionnement de la fiction. Car l’essentiel est là : le relais maintenant peut être pris ; c’est au lecteur d’agir. La pensée s’est emparée de son objet, les actions (et les passions) ; elle en a constitué la figuration nécessaire pour que nous puissions y entendre notre voix, et tenter, espérer, d’y « éclairer notre énigme ». À la compréhension des causes s’adjoint alors l’allègement des passions passées par le filtre de la raison.
Le personnage me fait accéder à mon tour au grand règne des métamorphoses. C’est par lui que le roman peut se faire expérience du monde, en m’obligeant à devenir moi aussi un être imaginaire. En lisant, je me livre, je m’oublie ; je me compare ; je m’absorbe, je m’absous. Sur le modèle et à l’image du personnage, je deviens autre. Comme disait Aragon : « Être ne suffit pas à l’homme / Il lui faut / Etre autre».
Autre par la médiation du personnage, autre, afin de devenir moi-même et, passant par ma propre absence, ayant fait le deuil de moi-même, capable de comprendre ce qu’il en est de ma vie. C’est ce que Sartre appelait la « générosité » du lecteur : cette mort feinte, cette transmutation provisoire par quoi j’accède au sens, à la compréhension.
Grâce à la fiction, chacun porte une tête multiple sur ses épaules ; il se fait une âme ouverte ; un cœur régénéré.
Danièle SALLENAVE, Le Don des morts. Sur la littérature, © Éd. Gallimard, 1991, p. 132-134.
En quoi L’adversaire correspond-il ou perturbe-t-il ce rapport au personnage ?
Le « mentir-vrai »
Par quel paradoxe magique, la fiction, l’œuvre d’art sont-elles plus à même de révéler la vérité profonde d’une époque, d’un être humain, qu’une étude historique, biologique, psychologique, anthropologique ou documentaire ? Ce que Aragon appelle le « mentir- vrai ».
Comment expliquer que n’importe quel volume de La Comédie Humaine de Balzac, à travers une histoire inventée, suggère mieux l’essence de la Restauration et de la Monarchie de Juillet qu’un livre d’histoire ? Que la pièce d’Ariane Mnouchkine, le Dernier Caravansérail en dit plus et plus fort que tous les articles et reportages réunis sur les sans-papiers ? On peut faire les mêmes remarques sur un film de Bergman ou Pasolini, un poème de René Char. Maints tableaux de Watteau représentant des fêtes galantes, donnent à voir surtout, au-delà de l’anecdote peinte, comme par transparence, par une vibration des tons et des valeurs, la vérité d’une société aristocratique secrètement travaillée par le pressentiment de sa disparition, et cela, quatre-vingts ans avant la Révolution. Une sculpture de Giacometti comme l’Homme qui marche n’est-elle pas une incroyable condensation d’une vérité humaine bouleversante sans commune mesure avec la réalité visible ?
C’est que l’œuvre d’art n’est pas simple message – c’est-à-dire vérité à transmettre (on serait alors dans l’idéologie). La vérité naît dans l’acte créateur, surgit de « crises » que Michel Leiris définit comme « les moments où le dehors semble brusquement répondre à la Sommation du dedans ». La vérité pour l’artiste est objet de quête : rendre visible l’invisible, faire entendre l’inouï ; il crée un monde parallèle, celui qui y pénètre ne trouve ni message, ni morale, ni leçon, mais se rencontre lui-même, à ses risques et périls.
Sabine Dotal , Cairn info
CAMUS, L’ETRANGER (oeuvre cursive)
Lecture de L’Etranger par Camus
Camus à propos de Meursault : Albert Camus, préface à l’édition américaine de l’Étranger, 1955
« J’ai résumé l’Étranger, il y a très longtemps, par une phrase dont je reconnais qu’elle est très paradoxale : dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à l’enterrement de sa mère risque d’être condamné à mort. Je voulais dire seulement que le héros du livre est condamné parce qu’il ne joue pas le jeu. En ce sens, il est étranger à la société où il vit, il erre, en marge, dans les faubourgs de la vie privée, solitaire, sensuelle. Et c’est pourquoi des lecteurs ont été tentés de le considérer comme une épave. On aura cependant une idée plus exacte du personnage, plus conforme en tout cas aux intentions de son auteur, si l’on se demande en quoi Meursault ne joue pas le jeu. La réponse est simple, il refuse de mentir. Mentir, ce n’est pas seulement dire ce qui n’est pas. C’est aussi, c’est surtout dire plus que ce qui est, et, en ce qui concerne le cœur humain, dire plus qu’on ne sent. C’est ce que nous faisons tous, tous les jours, pour simplifier la vie. »
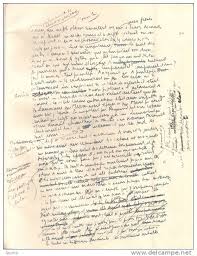
Le meurtre
Extrait du chapitre 6 (fin de la 1ère partie) “Le meurtre de l’Arabe”
J’ai pensé que je n’avais qu’un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J’ai fait quelques pas vers la source. L’Arabe n’a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l’air de rire. J’ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j’ai senti des gouttes de sueur s’amasser dans mes sourcils. C’était le même soleil que le jour où j’avais enterré maman et, comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. A cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j’ai fait un mouvement en avant. Je savais que c’était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d’un pas. Mais j’ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l’Arabe a tiré son couteau qu’il m’a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l’acier et c’était comme une longue lame étincelante qui m’atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d’un coup sur les paupières et les a recouvertes d’un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jailli du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C’est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m’a semblé que le ciel s’ouvrait de toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s’est tendu et j’ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j’ai touché le ventre poli de la crosse et c’est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J’ai secoué la sueur et le soleil. J’ai compris que j’avais détruit l’équilibre du jour, le silence exceptionnel d’une plage où j’avais été heureux. Alors, j’ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s’enfonçaient sans qu’il y parût. Et c’était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur.
Le procès
Extrait du chapitre 4 (2ème partie) “La plaidoirie de l’avocat” : une caricature de la justice.
L’après-midi, les grands ventilateurs brassaient toujours l’air épais de la salle et les petits éventails multicolores des jurés s’agitaient tous dans le même sens. La plaidoirie de mon avocat me semblait ne devoir jamais finir. A un moment donné, cependant, je l’ai écouté parce qu’il disait: « Il est vrai que j’ai tué ». Puis il a continué sur ce ton, disant « je » chaque fois qu’il parlait de moi. J’étais très étonné. Je me suis penché vers un gendarme et je lui ai demandé pourquoi. Il m’a dit de me taire et, après un moment, il a ajouté: « Tous les avocats font ça. » Moi, j’ai pensé que c’était m’écarter encore de l’affaire, me réduire à zéro et, en un certain sens, se substituer à moi. Mais je crois que j’étais déjà très loin de cette salle d’audience. D’ailleurs, mon avocat m’a semblé ridicule. Il a plaidé la provocation très rapidement et puis lui aussi a parlé de mon âme. Mais il m’a paru qu’il avait beaucoup moins de talent que le procureur. « Moi aussi, a-t-il dit, je me suis penché sur cette âme, mais, contrairement à l’éminent représentant du ministère public, j’ai trouvé quelque chose et je puis dire que j’y ai lu à livre ouvert. » II y avait lu que j’étais un honnête homme, un travailleur régulier, infatigable, fidèle à la maison qui l’employait, aimé de tous et compatissant aux misères d’autrui. Pour lui, j’étais un fils modèle qui avait soutenu sa mère aussi longtemps qu’il l’avait pu. Finalement j’avais espéré qu’une maison de retraite donnerait à la vieille femme le confort que mes moyens ne me permettaient pas de lui procurer. « Je m’étonne, messieurs, a-t-il ajouté, qu’on ait mené si grand bruit autour de cet asile. Car enfin, s’il fallait donner une preuve de l’utilité et de la grandeur de ces institutions, il faudrait bien dire que c’est l’Etat lui-même qui les subventionne. » Seulement, il n’a pas parlé de l’enterrement et j’ai senti que cela manquait dans sa plaidoirie. Mais à cause de toutes ces longues phrases, de toutes ces journées et ces heures interminables pendant lesquelles on avait parlé de mon âme, j’ai eu l’impression que tout devenait comme une eau incolore où je trouvais le vertige. A la fin, je me souviens seulement que, de la rue et à travers tout l’espace des salles et des prétoires, pendant que mon avocat continuait à parler, la trompette d’un marchand de glace a résonné jusqu’à moi. J’ai été assailli des souvenirs d’une vie qui ne m’appartenait plus, mais où j’avais trouvé les plus pauvres et les plus tenaces de mes joies: des odeurs d’été, le quartier que j’aimais, un certain ciel du soir, le rire et les robes de Marie. Tout ce que je faisais d’inutile en ce lieu m’est alors remonté à la gorge et je n’ai eu qu’une hâte, c’est qu’on en finisse et que je retrouve ma cellule avec le sommeil. C’est à peine si j’ai entendu mon avocat s’écrier, pour finir, que les jurés ne voudraient pas envoyer à la mort un travailleur honnête perdu par une minute d’égarement, et demander les circonstances atténuantes pour un crime dont je traînais déjà, comme le plus sûr de mes châtiments, le remords éternel. La cour a suspendu l’audience et l’avocat s’est assis d’un air épuisé. Mais ses collègues sont venus vers lui pour lui serrer la main. J’ai entendu: « Magnifique, mon cher. » L’un d’eux m’a même pris à témoin: « Hein? » m’a-t-il dit. J’ai acquiescé, mais mon compliment n’était pas sincère, parce que j’étais trop fatigué.
La religion
Alors que Meursault attend son recours en grâce, un prêtre vient lui demander de se repentir. Meursault refuse . Il ne le peut pas , ni d’ailleurs se pardonner.
Et lorsque le prêtre appelle Meursault “mon fils”, cela déclenche en lui une réaction très forte, très violente. Il se déchaîne alors contre lui en le couvrant d’injures, dans une explosion de rage. Meursault dénonce alors l’injustice, se révolte contre les accusations.
Meursault n’est alors plus l’homme du « cela m’était égal » .
En effet, il pose pour la première fois un vrai choix ; un choix qui l’engage tout entier et qui répond à la question philosophique du Mythe de Sisyphe. En refusant l’espoir chrétien que lui offre le prêtre, il rejette le « plus tard » et « l’ailleurs » du christianisme et dit sa foi indéfectible en cette vie qu’il s’apprête pourtant à perdre.
Meursault exprime alors sa foi en la vie : « aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme. Il n’était même pas sûr d’être en vie puisqu’il vivait comme un mort. Moi, j’avais l’air d’avoir les mains vides. Mais j’étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n’avais que cela. Mais du moins, je tenais cette vérité autant qu’elle me tenait. »
Cette scène est donc essentielle puisque c’est alors que le personnage naît à la conscience.
Meursault, qui a vécu jusque-là guidé par l’instinct, se réapproprie ici son existence .
A la veille de son exécution il devient le personnage camusien par excellence tant la proximité de la mort a décuplé en lui la passion de vivre.
Albert CAMUS écrira en effet dans les notes pour Le Premier homme : « […] pure passion de vivre affrontée à une mort totale »,
Extrait du chapitre 5 (2ème partie) “Excipit” : la mort comme révélation de l’homme à lui-même.
Lui parti, j’ai retrouvé le calme. J’étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j’ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu’à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. A ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m’était à jamais indifférent.
Pour la première fois depuis bien longtemps, j’ai pensé à maman. Il m’a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d’une vie elle avait pris un «fiancé», pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas, là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s’éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s’y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne, personne n’avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette
grande colère m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant cette nuit chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été heureux, et que je l’étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine.
Romand et Meursault.
Quel est le rapport que les deux personnages entretiennent avec la vérité ?
- Le problème de Meursault, c’est qu’il ne peut pas mentir
- Le problème de Romand c’est qu’il ne peut pas dire la vérité.
Meursault est un personnage qui refuse de mentir, de jouer la comédie de la société, et de s’inventer des émotions qu’il ne ressent pas. Comme l’écrit Pierre-Georges Castex, Meursault est un « martyr de la vérité »
« Meursault refuse de mentir. Mentir, ce n’est pas seulement dire ce qui n’est pas. C’est aussi, et surtout, dire plus que ce qui est, et, en ce qui concerne le cœur humain, dire plus que ce qu’on ne sent. Et c’est finalement ceci qui lui sera reproché lors de son procès. Pensons à cette réplique du procureur : « il a déclaré que je n’avais rien à faire dans un société dont je méconnaissais les règles les plus essentielles »
Romand, lui va tuer sa famille parce qu’il refuse qu’elle découvre la vérité sur son compte. Le rapport de Romand avec la vérité est très trouble. Lors de son procès, on apprend qu’enfant, on lui interdisait formellement de mentir, de se vanter, mais en même temps, on lui apprenait la pratique du pieux mensonge, celui qui n’est pas censé faire de mal – par exemple, pour ne pas blesser sa mère.
C’est peut-être ici que les deux personnages s’opposent le plus : on reproche à Meursault de ne pas montrer grand peine pendant l’enterrement de sa mère, de ne pas mentir, donc. Quant à Romand, il intègre dès son plus jeune âge que ce type de mensonge est essentiel au bonheur de chacun.
Selon Carrère, cet apprentissage contradictoire que Romand a subi est probablement à la source du drame : « Cela paraît exagéré, la façon dont un petit mensonge de base produit cet engrenage qui dure dix-huit ans et aboutit au drame » (interview de l’Express).
Meursault et Romand : des personnages vides ?
On a souvent tendance à considérer Meursault comme un personnage vide, une sorte de mort-vivant dénué d’intérêt pour quoi que ce soit. Si un être vide signifie « un être vide de pensées », on aurait tort de le croire. Meursault réfléchit souvent, pèse souvent le pour et les contre (« d’un côté… de l’autre »), juge souvent les paroles de ses interlocuteurs : il juge que le télégramme lui annonçant la mort de sa mère « ne veut rien dire », remarque que Masson complète « tout ce qu’il avançait par un « et je dirai plus », même quand, au fond, il n’ajoutait rien au sens de sa phrase ».
Quand il est condamné, il remarque surtout la « forme bizarre » du réquisitoire.) Meursault semble surtout incapable de sentiments sophistiqués. La manière dont il répond à l’amour de Marie, son étrange vide émotif lors de l’enterrement de sa mère en témoignent. Mais c’est que Meursault n’est pas un « roseau pensant » : il se contente d’exister, et d’exister pleinement, sans mettre entre lui et le monde la moindre barrière de principe, le moindre a priori. Son appartenance fusionnelle au monde se traduit par son amour de la nature, un attachement fondamental à la mer. Ainsi, Meursault n’est pas un personnage vide, malgré les apparences. Si on peut le qualifier de lacunaire (il « méconnaît les règles les plus essentielles » de la société), on ne peut le considérer comme vide.
Romand, en apparences, n’est, lui, certainement pas « vide ». On le considère pendant des années comme le médecin et chercheur à l’OMS qu’il déclarait être, alors qu’il avait mis un terme à ses études de médecine après deux années. Pendant dix-huit ans, sa famille et ses amis ont cru à ce personnage. En fait, tout ce temps, alors qu’il devait être au travail, Romand passait son temps sur des ères d’autoroutes, ou à errer dans les forêts. Un immense pan de son existence n’a donc aucun contenu, et ne consiste qu’en une matière vide : le temps. C’est cet aspect-là qui a le plus intéressé Carrère : « C’est sur ce vide-là que j’avais envie d’écrire, sur ce qui pouvait tourner dans sa tête pendant les journées passées sur des parkings d’autoroute. J’ai essayé d’encadrer ce vide pour que le lecteur perçoive intimement ce que c’était que de vivre dans ce monde vide et blanc ». (entretien avec l’Express).
Selon Carrère, Romand n’avait, pour ainsi dire, pas plus de corps que de diplôme de médecine : en évoquant sa vie sexuelle pauvre, le journaliste dit de Romand que « c’était un homme non touché, non caressé. A la fin, il allait voir des masseuses pour enfin avoir un corps ». Carrère renchérit : « Oui, il allait dans des salons de massage et il avait l’impression d’exister un peu ». Tout le contraire de Meursault qui, lui, est avant tout un corps, un récepteur sensible des éléments cosmiques (les étoiles, le soleil) et des choses de l’amour (les nuits avec Marie).
Romand, Meursault, et l’homme révolté
Romand refuse sa condition d’homme médiocre, et va peu à peu se réfugier dans une illusion qui lui permettra, s’il parvient à l’imposer à ses proches, de se transformer en un personnage qui lui convient. Romand n’accepte pas sa propre vie, sa propre identité. Il la nie, et c’est en cela que l’on peut dire qu’il est le contraire d’un homme révolté.
Carrère, dans un entretien accordé à l’Express (février 2000), présente Romand comme un homme qui a perpétuellement échoué dans sa bataille l’opposant à cet « adversaire », ce démon, qui est en chacun de nous, et qui se définit par le mensonge : « Pour le pauvre bonhomme qu’est Jean-Claude Romand, toute la vie a été une défaite dans ce combat ». Romand est un perdant ; son échec se traduit par le fait qu’il veut absolument donner une belle image de lui, et se double quand il choisit de se plonger dans la foi chrétienne, qui lui permet d’être pardonné et de croire à la possibilité d’une vie de pénitence, et du salut de son âme.
Chez Meursault, on assiste au phénomène inverse. Meursault, lui, est incapable de mentir, ni même de se mentir.
À la fin du roman, il prend pleinement conscience de la tragédie de l’homme : il s’apprête à mourir après avoir vécu un semblant de vie. Mais au lieu de se plonger dans une illusion salvatrice (mais une illusion tout de même, donc une erreur – telles la repentance et la foi), il finit par accepter son sort, et ne s’en sent que plus fier.
Histoire des arts
Francisco de Goya : Saturne dévorant un de ses enfants – 1821-1823
Peinture murale transférée sur toile, 146 x 83 cm – Madrid, Prado © 2010. Photo Scala, Florence
C’est dans sa dernière demeure, dans la campagne proche de Madrid, que le vieux Francisco Goya alors septuagénaire réalise entre 1821 et 1823 un ensemble d’une quinzaine de fresques qui rentreront dans l’histoire sous le nom de «peintures noires». Parmi elles, entre d’autres images de violence, de folie ou de sabbats, figure cette image cauchemardesque du dieu Saturne. Conformément à la mythologie grecque, Goya l’a peint en train de dévorer sa progéniture pour empêcher un de ses enfants de le détrôner comme l’a prédit un oracle. Cette fresque très sombre et tourmentée,qui semble rompre avec les portraits princiers et les scènes champêtres auxquels il s’est souvent consacré, est en fait l’aboutissement d’un long travail sur la sauvagerie de la nature humaine. Depuis vingt-cinq ans, dans ses gravures notamment, en marge de sa carrière de peintre de cour, Goya a en effet illustré les pires aspects de la société espagnole, les plus injustes et meurtriers.

L’Espagne des Lumières, celle des «Ilustrados» dont Goya se sent proche, a subi au début du XIXème siècle un conflit tragique dont elle ne se relèvera jamais tout à fait : l’occupation napoléonienne. De 1808 à 1812, les troupes impériales et les résistants républicains se sont affrontés sur le sol ibérique dans une guérilla sans merci, sanglante et dévastatrice. Vingt ans après, Napoléon déchu, les plaies sont encore ouvertes et le pays toujours divisé, entre les partisans d’une monarchie autoritaire et les défenseurs des idées libérales. Mais dans les campagnes, loin des centres de décisions et des cercles de réflexion politiques, plus loin encore de la philosophie des Ilustrados qui tiennent la Raison pour seule garante du progrès, c’est un autre combat qui fait rage : celui de l’Eglise catholique et de l’Inquisition contre toutes les formes de croyances ésotériques, des diseuses de bonne aventure aux adeptes des rituels sataniques.
Dans ce contexte, la référence au sinistre dieu Saturne semble prendre des sens multiples, qui dépassent de loin le simple clin d’œil à l’Antiquité gréco-romaine. Est-ce l’expression de l’angoisse d’un vieillard isolé par la surdité au crépuscule de sa vie ? Celle de la rage d’un homme qui a assisté aux pires atrocités de la guerre ? Est-ce une représentation a posteriori de l’ogre napoléonien ? Une métaphore de la Monarchie qui dévore l’idéal républicain ? Peut-être est-ce en réalité tout cela en même temps : ce Saturne incarnerait alors le Mal suprême qui gangrène le monde et les hommes. Ce Mal qui est la négation de la Raison sur laquelle toute société humaine devrait être bâtie. Ce même Mal qu’on retrouve chez les sorcières, les sauvages et les monstres. Saturne, après tout, n’a-t-il pas été assimilé dès le Moyen-Âge à la figure de Satan?
Alors que le paysage artistique du début du XIXème siècle est largement dominé par l’ordre clair, précis et mesuré du Néo-classicisme, Goya n’hésite pas à adopter une touche libre et lâche, optant pour des tons résolument sombres qui plongent le monstre dans une pénombre épaisse. En cela il annonce clairement l’avènement du Romantisme, avec l’exaltation de la peine, l’esthétisation de l’effroi et le recours au fantastique. Goya souffre, c’est évident, mais de cette souffrance inspiratrice des artistes qu’on nomme mélancolie, et dont l’astre – est-ce un hasard ? – est la planète Saturne ! Mais surtout, ce qui fait de cette fresque et des autres peintures noires des œuvres à part, c’est que Goya les a peintes sans perspective d’exposition. Il les a réalisées chez lui, directement à même les murs, alors qu’il n’avait aucune raison d’imaginer qu’un jour elles seraient transférées sur toiles et conservées dans le plus célèbre musée madrilène. Cette démarche totalement désintéressée, qui ressemble fort à un exorcisme, ancre ce Saturne dans une logique extrêmement moderne, loin de la tradition des artistes répondant à des commandes de clients nobles ou fortunés.

Cliquez sur l’icône du Louvre pour lire l’analyse proposée.
ENTRAINEMENT E.A.F

